Joaillerie
Braquage au Louvre : les huit joyaux d’exception qui ont marqué l’histoire de la joaillerie
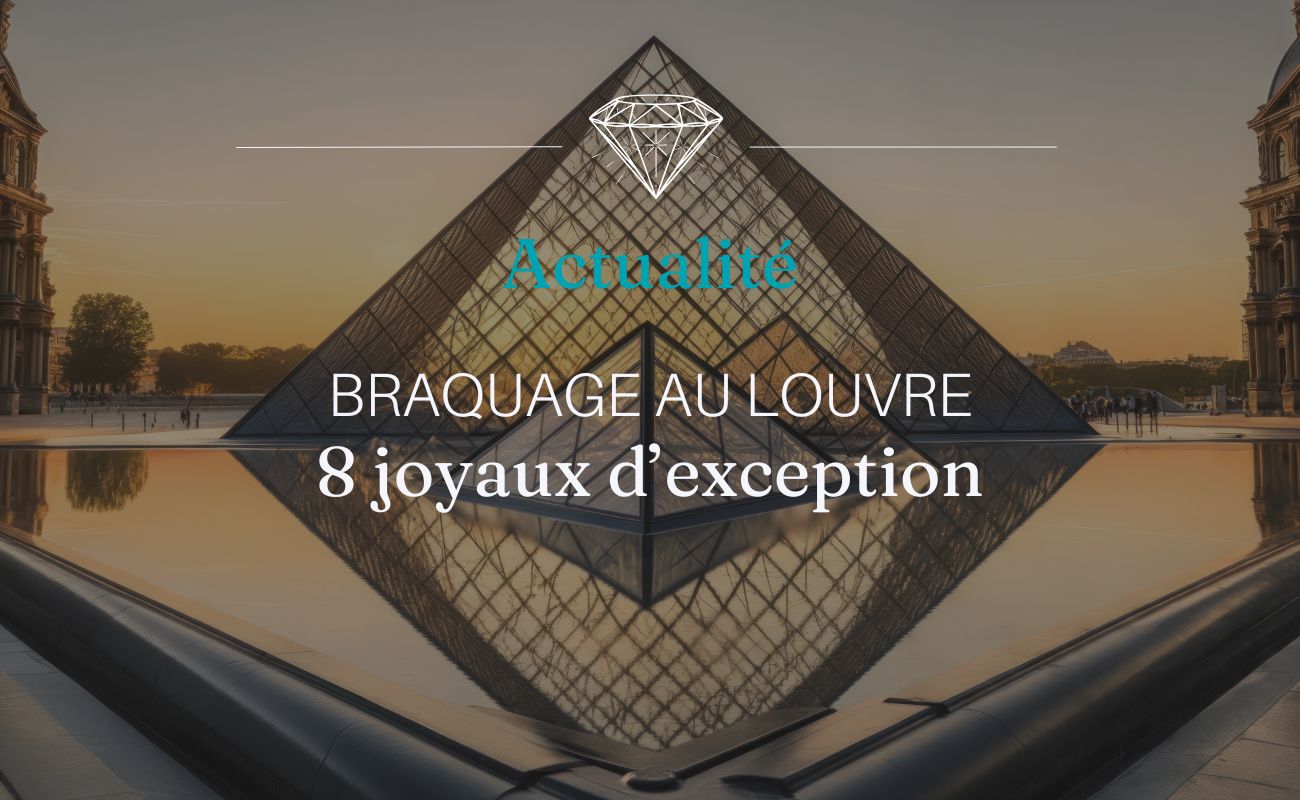
Le 19 octobre 2025, entre 9 h 30 et 9 h 37, le musée du Louvre a été le théâtre d’un braquage aussi audacieux qu’inattendu. En moins de dix minutes, huit bijoux inestimables appartenant à la collection des Joyaux de la Couronne ont été dérobés dans la galerie d’Apollon, située au premier étage de l’aile Denon. Ces pièces d’une valeur historique et artistique exceptionnelle représentaient des siècles de savoir-faire joaillier français.
Un vol minutieusement orchestré
Les voleurs ont agi en plein jour, profitant d’un moment d’ouverture au public.
Selon les premiers rapports d’enquête, ils auraient neutralisé le dispositif de surveillance sans déclencher d’alarme, opérant avec une efficacité redoutable entre 9 h 30 et 9 h 37.
La Brigade de Répression du Banditisme et l’Office Central de lutte contre le trafic des biens culturels ont été immédiatement saisis de l’affaire.
Leur objectif était clair : s’emparer des bijoux les plus emblématiques, ceux qui incarnent la grandeur du patrimoine joaillier français.
Les huit bijoux volés : chefs-d’œuvre de la haute joaillerie
1️. Le diadème de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense
Créé à Paris entre 1800 et 1825, ce diadème est un joyau du style Empire. Il se compose de 24 saphirs de Ceylan aux reflets bleu royal et de plus de 1 000 diamants taille ancienne, montés sur or et argent. Porté par Hortense de Beauharnais puis Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, il symbolisait la puissance et la continuité dynastique. Sa symétrie et la pureté des gemmes en font une pièce emblématique de la joaillerie du Premier Empire.

2️. Le collier assorti de la même parure
Ce collier articulé, assorti au diadème, réunissait 8 saphirs de formes variées (ovales, rectangulaires et en coussin) et 631 diamants finement sertis. Chaque pierre était montée sur un système articulé permettant un tombé fluide, démontrant la maîtrise technique des ateliers parisiens du XIXᵉ siècle. Chef-d’œuvre d’équilibre et d’élégance, il illustrait le passage de l’opulence impériale à la grâce plus discrète de la Restauration.

3️. Les boucles d’oreilles saphirs et diamants
Dernières pièces de la parure, ces boucles d’oreilles associaient deux saphirs centraux à une constellation d’une cinquantaine de diamants taille rose. Leur design pendeloque, à la fois léger et mobile, faisait ressortir la couleur profonde des saphirs. Elles témoignaient du goût de l’époque pour la brillance et la symétrie, tout en restant étonnamment modernes par leur équilibre.

4️. Le collier d’émeraudes de l’impératrice Marie-Louise
Offert par Napoléon Ier à Marie-Louise d’Autriche lors de leur mariage en 1810, ce collier est l’un des plus célèbres joyaux impériaux. Il comportait 32 émeraudes (dont 10 en poire) et 1 138 diamants, montés sur une structure en or et argent en forme de guirlande. L’association du vert et du blanc incarnait la fertilité et la pureté, deux vertus impériales. Sa conception équilibrée et la qualité des gemmes en faisaient une œuvre d’art joaillière à part entière.
5️. Les boucles d’oreilles en émeraudes de Marie-Louise
Complétant la parure d’émeraudes, ces boucles d’oreilles comptaient 6 émeraudes, dont deux pierres poire de 45,20 carats chacune, et 108 diamants. Leur serti à griffes laissait filtrer la lumière à travers les gemmes, soulignant l’intensité de leur vert profond. Une prouesse d’équilibre visuel : lourdes par la taille des pierres, mais d’une élégance aérienne.

6️. La broche reliquaire aux diamants Mazarins
Réalisée vers 1855, cette broche unique réunissait 94 diamants, dont deux célèbres diamants Mazarins ayant appartenu à Louis XIV. Montée sur argent doré, elle alliait la fonction d’un bijou de prestige et celle d’un objet de mémoire. Symbole du lien entre foi et splendeur, elle incarnait à la perfection le style romantique du milieu du XIXᵉ siècle.

7️. Le diadème de l’impératrice Eugénie
Daté de 1853, ce diadème d’apparat rassemblait 212 perles naturelles (dont 17 poires), 1 998 diamants et environ 1 000 diamants taille rose. Les perles, calibrées avec minutie, conféraient une douceur satinée à la monture, tandis que les diamants offraient un éclat spectaculaire. Ce bijou illustrait l’élégance somptueuse d’Eugénie de Montijo, véritable icône du Second Empire et ambassadrice du luxe français.

8️. Le grand nœud de corsage de l’impératrice Eugénie
Créé vers 1855 par le joaillier François Kramer, ce nœud monumental était composé de 2 438 diamants et 196 diamants taille rose. Articulé, orné de pampilles mobiles, il symbolisait la fusion entre l’orfèvrerie et la sculpture joaillière. Bijou de parade par excellence, il témoignait du raffinement extrême du Second Empire, où la lumière et le mouvement étaient rois.

La couronne d’Eugénie : un joyau sauvé in extremis
Lors de leur fuite précipitée, les voleurs ont laissé tomber la couronne d’Eugénie, qui s’est détachée de son support en verre. Les agents de sécurité l’ont retrouvée au sol quelques minutes après l’alerte. Cette pièce, symbole du règne de Napoléon III et chef-d’œuvre de symétrie et de sertissage, a ainsi échappé de peu à la disparition. Un miracle, selon plusieurs conservateurs du Louvre, qui y voient un signe d’espoir au milieu du désastre.
Trois diamants historiques épargnés
Malgré le vol spectaculaire, trois des pierres les plus célèbres du monde sont restées en sécurité dans la galerie d’Apollon :
- Le Régent - considéré comme le diamant le plus pur et le plus beau du monde, découvert en Inde au XVIIᵉ siècle.
- Le Sancy - diamant de 55,23 carats, porté par Napoléon lors de son sacre.
- L’Hortensia - diamant rose de 20 carats, connu pour sa teinte subtile et son histoire fascinante.
Ces gemmes, emblèmes de la monarchie et de l’Empire, seront désormais encore plus étroitement surveillées après ce braquage sans précédent.
Un patrimoine joaillier blessé mais immortel
Si ces huit joyaux ont disparu, leur histoire et leur éclat demeurent dans la mémoire collective. Ces pièces illustraient l’âge d’or de la joaillerie française, mêlant l’art du sertissage, le choix des gemmes et la symbolique du pouvoir. Ce braquage rappelle que la joaillerie est bien plus qu’un art décoratif : elle est un patrimoine vivant, un témoin du génie humain et de la beauté intemporelle des pierres.